|
LE
JUDO
De
Jigoro Kano à nos jours !

L'HISTOIRE
DU JUDO
Le judo a été créé en 1882 par un jeune
étudiant japonais nommé Jigoro Kano, qui en avait puisé les éléments essentiels
dans le ju-jitsu, terme désignant les techniques de combat à mains nues
utilisées par les samouraïs, ces rudes guerriers nippons. Jigoro Kano supprima
tous les aspects dangereux de ces méthodes de combat pour n'en retenir que les
éléments susceptibles de constituer une discipline physique et mentale hautement
éducative.
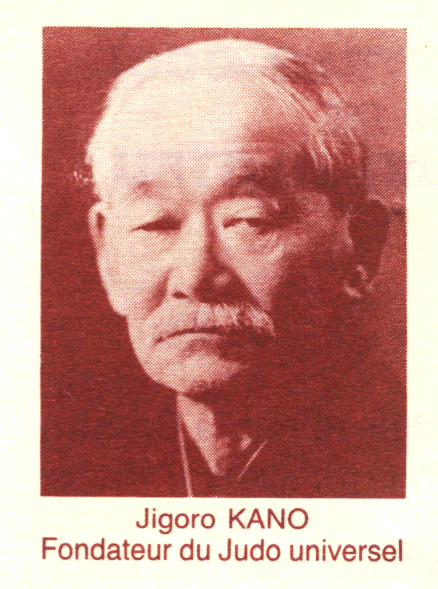
En devenant un sport pratiqué désormais dans le monde entier et admis aux jeux
Olympiques, le judo, tout en restant fidèle aux principes de base définis par
son créateur, a évolué sous l'impulsion d'un nombre croissant de professeurs et
d'experts, soucieux de toujours en comprendre mieux les mécanismes, ainsi que de
champions visant, pour leur part, l'efficacité immédiate, laquelle assure la
victoire au cours des compétitions officielles.
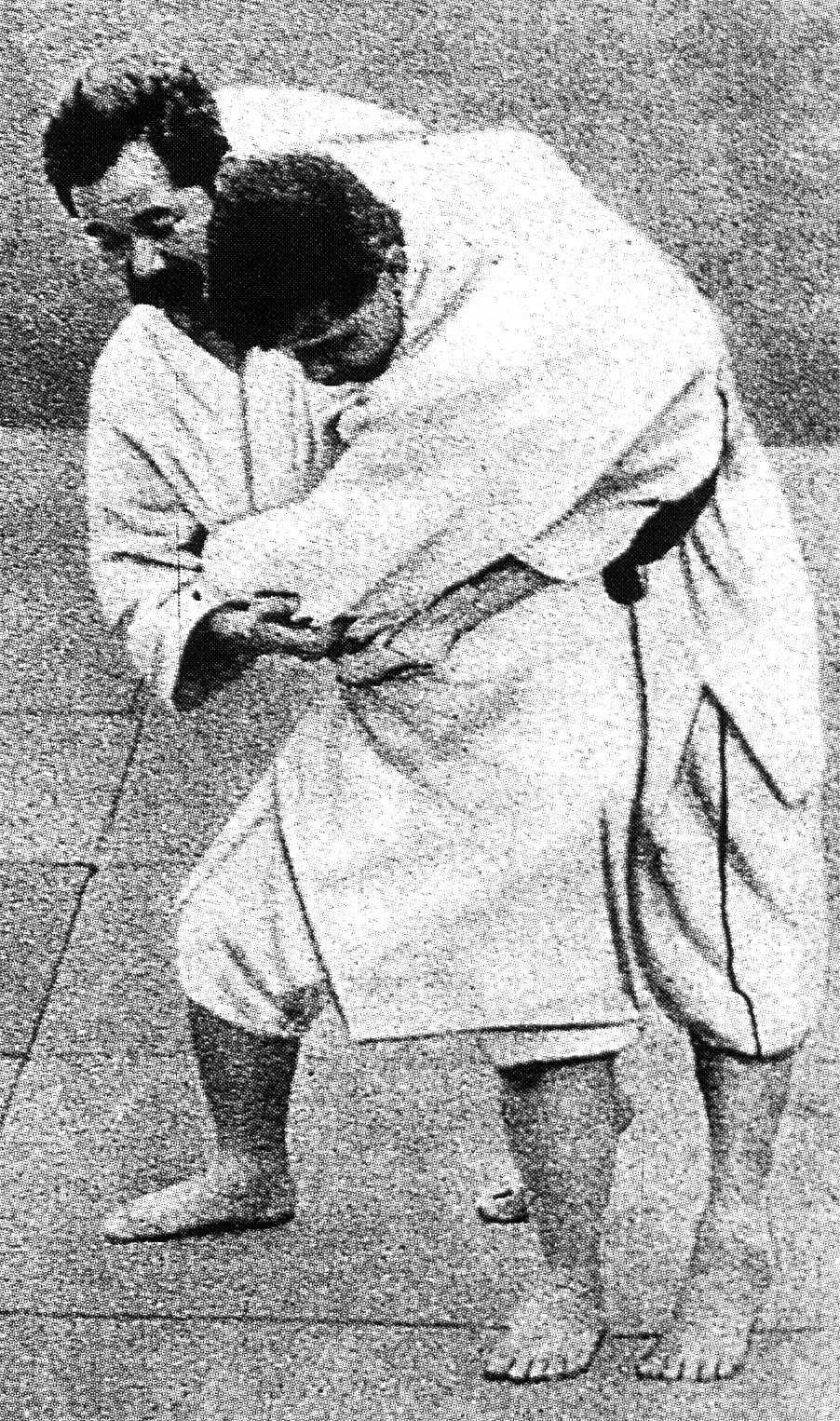
Jigoro Kano et ses premiers disciples ont conçu une gamme complète de
techniques, faisant toutes appel au même principe de la " voie de la souplesse "
-définition du mot " judo " - mettant en jeu le corps dans son ensemble, mais se
différenciant les unes des autres en divers groupes, selon que l'on utilise plus
ou moins les hanches, les bras, les jambes... ou, pour ce qui concerne le judo
au sol, faisant appel à des notions de physique et d'anatomie, pour les clés de
bras et les étranglements.

L'EPOQUE DES SAMOURAÏS
Le ju-jitsu (ju = souplesse, jitsu = technique) est
l'ensemble des techniques qu'utilisaient autrefois les samouraïs, ces
redoutables guerriers japonais, au cours de leurs combats à mains nues et qui se
terminaient le plus souvent par la mort de l'un des adversaires.

Le secret de ces techniques était jalousement gardé et lorsque le Japon s'ouvrit
à la civilisation occidentale, au milieu du XIXième siècle, elles tombèrent dans
un oubli presque total.

L'EPOQUE DE JIGORO KANO
Mais, vers 1875, un jeune étudiant du nom
de Jigoro Kano, malingre, de petite taille et toujours brimé par ses camarades,
décida de retrouver les secrets du ju-jitsu afin de les utiliser pour se
défendre.
Après de longues et patientes études, Jigoro Kano créa le judo et ouvrit la
première salle, le Kodokan, en 1882.
Le judo se différenciait du ju-jitsu en ceci qu'il n'était plus une méthode
guerrière de combat, mais au contraire une voie éducative (ju = souplesse, do =
voie) de perfectionement moral et physique.
Le judo utilisait les techniques de projection (nage-waza), de contrôles, clefs
et étranglements (katame-waza) et de coups frappés (atémi-waza).
Ce dernier groupe, écarté de la pratique du judo sportif, pour des raisons
évidentes de sécurité, n'en demeure pas moins indissociable des deux autres pour
constituer le judo originel crée par Jigoro Kano.
L'EPOQUE MODERNE
Le ju-jitsu - self défense, technique ou compétition
- est donc un retour aux sources et par là même il retrouve sa vocation
première, celle qui inspira Jigoro Kano : être une défense pour chacun, quels
que soient sa taille, son poids, sa force ou son âge.

LA PROGRESSION FRANÇAISE
Les techniques découlent souvent les unes des autres
et les difficultés à surmonter pour les assimiler ne sont pas toujours les
mêmes. Aussi est-il indispensable de suivre une progression adaptée à un
apprentissage judicieusement dosé dans la difficulté.
C'est ainsi que le débutant, ceinture blanche, obtiendra progressivement les
connaissances pour mériter les grades supérieurs, ceintures jaune, orange,
verte, bleue, ou marron, et enfin noire.
Lorsqu'il aura atteint ce niveau et qu'il aura fait le tour de toute la
progression, le pratiquant pourra, s'il le souhaite, se spécialiser dans un
nombre restreint de mouvements qu'il aura déterminé comme lui convenant plus
particulièrement, en fonction de son tempérament, de ses goûts, de sa
morphologie, de ses aptitudes physiques, et qu'il pourra personnaliser.
En France, il existe une progression officielle fixée par la Fédération, à
laquelle se réfèrent tous les enseignants. Le judo s'étant débarrassé du voile
de mystère et de secret qui l'entourait à ses débuts, chacun peut désormais
l'étudier de façon complète et précise. Les techniques pratiquées en France sont
les mêmes que celles du Japon ou de tout autre pays du monde.
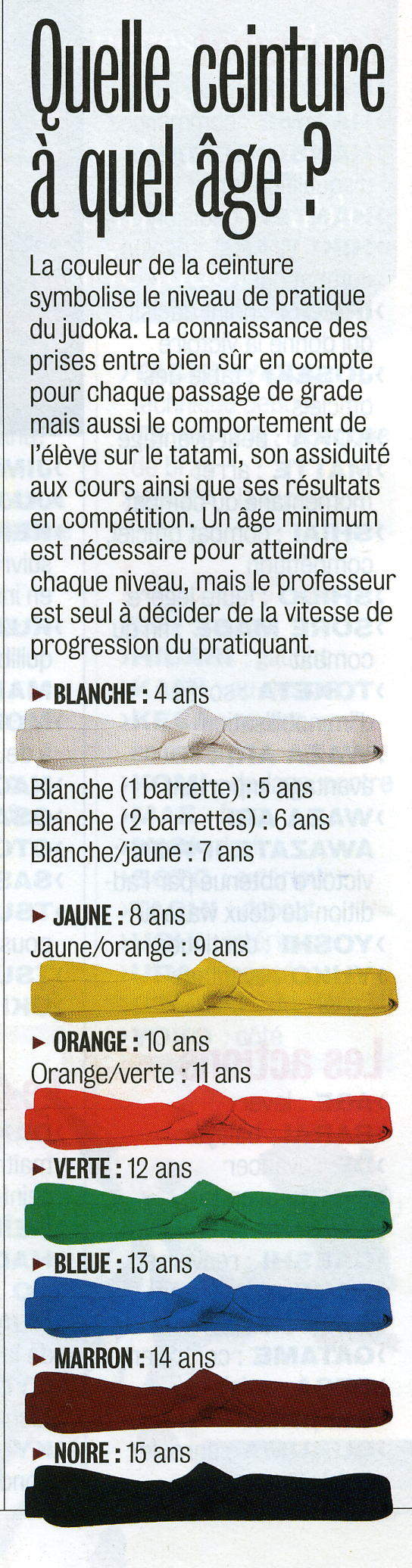
LA PRATIQUE DU JUDO
Le judo se pratique dans une salle spécialement
adaptée, le " dojo ", mot japonais qui signifie " lieu où l'on étudie la voie ".
Le sol est recouvert de tatamis, tapis autrefois en paille, (les mêmes que ceux
qui constituent le sol des maisons japonaises traditionnelles), aujourd'hui
fabriqués en mousse synthétique recouverte de bâche, suffisamment fermes pour
que les déplacements y soient aisés (le judo se pratique pieds nus) mais assez
souples pour que les chutes soient convenablement amorties, sans risque
d'accident.
Le vêtement de judo s'appelle un " judogi ", dénommé communément kimono. Il est
en tissu souple et très résistant. La veste se tient fermée, croisée, maintenue
par une ceinture de toile qui fait deux fois le tour de la taille, et serrée par
un nœud plat.
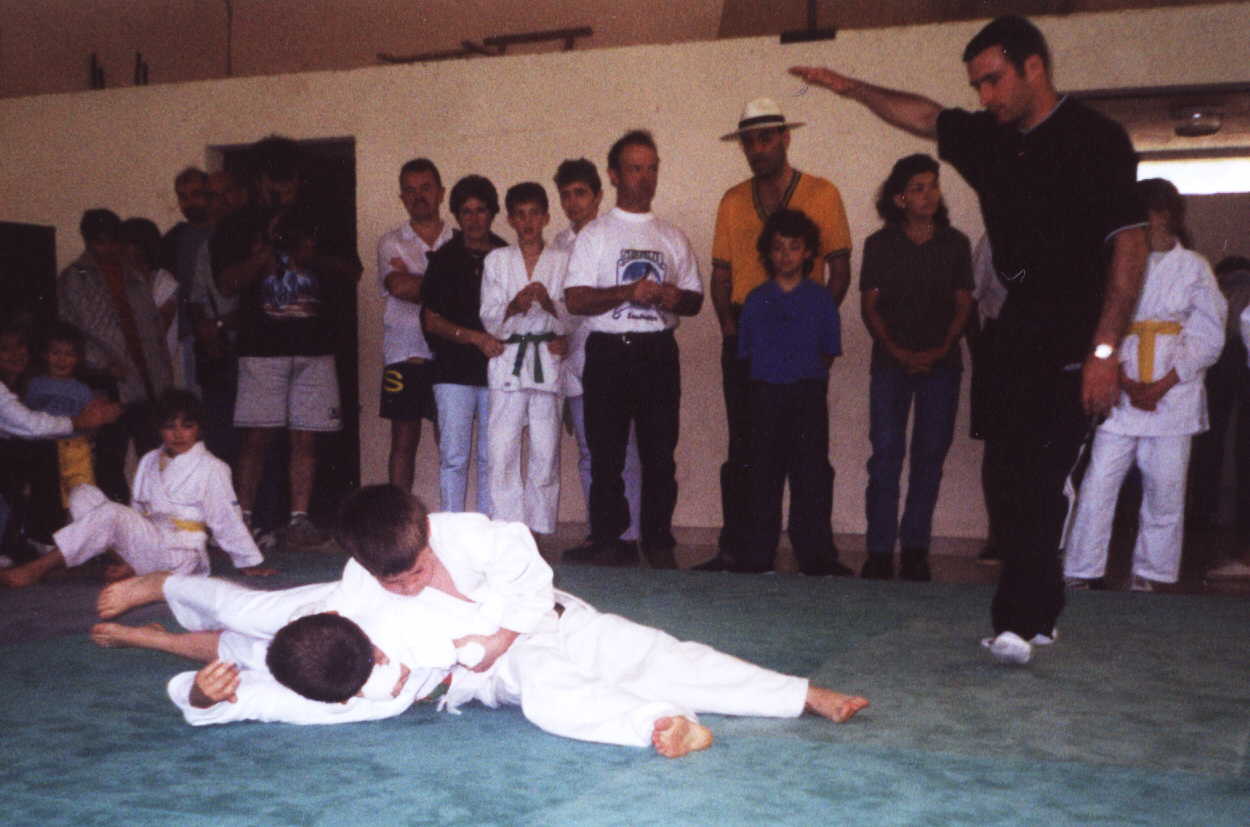
LE KUMI-KATA
La saisie du kimono, la garde (kumi-kata en
japonais), s'obtient en prenant avec la main droite le revers du kimono du
partenaire sous la clavicule, et en prenant la manche opposée, de la main
gauche, à hauteur du coude. Cette position n'est pas obligatoire, on peut
prendre le revers plus haut ou la manche plus bas, mais elle est fondamentale,
c'est celle qui se prête le mieux à la plus grande variété d'attaques et à la
pratique de l'ensemble des techniques.
La meilleure posture du corps est la position verticale, naturelle, (shizen-taï
en japonais), les pieds suffisamment écartés pour avoir une bonne stabilité tout
en conservant l'aisance nécessaire pour se déplacer sans compromettre son
équilibre. Les déplacements se font en évitant de croiser les pieds ou de les
lever trop haut, le poids du corps restant le plus possible réparti sur les deux
appuis. La position défensive (jigo-taï), jambes écartées et fléchies, fesse en
arrière, bras tendus, est une attitude adoptée surtout en compétition.
LE COUPLE : TORI & UKE
Lorsque deux judokas s'entraînent ou étudient
ensemble, l'un est désigné par le terme " Tori " (celui qui porte le mouvement)
et l'autre par le terme " Uke " (celui qui subit le mouvement).

LE DESEQUILIBRE
Toute attaque doit être précédée d'un déséquilibre
de l'adversaire, avant, arrière ou latéral, tout en conservant soi-même une
aisance de mouvement qui permette d'appliquer la technique appropriée, cette
aisance se manifestant dans le dynamisme, la vitesse et la précision du
déplacement et du placement. C'est ce qui constitue ce que les judokas appellent
" la forme du corps ".
Le déséquilibre de l'adversaire s'obtient en profitant de son déplacement, soit
par notre propre action, en amplifiant son déplacement, soit en créant chez lui
une réaction. (Exemple le plus simple, on pousse l'adversaire vers l'arrière
pour qu'il résiste en poussant lui-même vers l'avant. En inversant brusquement
notre action, nous le tirons cette fois vers l'avant. Notre traction s'ajoutant
à sa poussée, provoque son déséquilibre vers l'avant).
LE RITUEL
Sport traditionnel, le judo reste attache à un
certain rituel, dont le salut fait partie. En saluant le tapis avant d'y monter,
en saluant le professeur, ou les arbitres lors d'une compétition, enfin en
saluant son adversaire avant chaque combat, le judoka manifeste le respect qu'il
porte aux uns et aux autres. Il considère d'ailleurs son adversaire avant tout
comme un partenaire, puisqu'il lui serait impossible de progresser s'il n'avait
à vaincre l'opposition de ce dernier. Ainsi, les deux adversaires - partenaires
s'entraident-ils mutuellement.
Au début et à la fin de chaque leçon, les élèves, tous alignés dans l'ordre de
leur grade, à genoux, silencieux, judogi et ceinture bien en place, saluent
ensemble les professeurs, placés dans la plupart des dojos, devant un portrait
de Jigoro Kano situé à la place d'honneur. C'est un témoignage de reconnaissance
à l'égard de celui qui créa le judo et de ceux qui l'enseignent. C'est aussi un
moment de concentration et de relaxation, de discipline personnelle et
collective physique et mentale, de sérénité. Cette discipline confère au judoka
une remarquable aptitude à retrouver son calme et son sang froid en toutes
circonstances.
LA PREPARATION
Une séance de judo commence toujours par une série
de mouvements d'échauffement destinés à préparer les muscles et les
articulations aux efforts de la leçon, puis par des séries de chutes sur
l'arrière, sur le côté, sur l'avant.
Un autre exercice spécifique au judo s'appelle " uchi-komi ". C'est la
répétition rapide, sur place ou en déplacement, de l'entrée d'un mouvement, vite
et fort, mais sans effectuer la projection. Cet exercice développe la vitesse,
la précision du geste et la synchronisation de l'action des différentes parties
du corps. Il favorise aussi le développement musculaire et la résistance
cardiaque.
C'est après cette séparation que l'élève peut passer au travail technique
proprement dit.
LES TECHNIQUES
L'ensemble des techniques se classe en différents
groupes désignés par des termes japonais, selon qu'elles se pratiquent debout ou
au sol et selon la partie du corps la plus sollicitée.
Le travail debout s'appelle nage-waza (prononcer nagué), qui signifie:
techniques de projection et qui comprend les techniques de jambes (ashi-waza),
de hanches (koshi-waza), de bras (te-wasa) et les sacrifices (sutémi-waza).
Le travail au sol se nomme ne-waza. Il comprend les immobilisations (katame-waza),
les étranglements (shime-waza) et les luxations (kansetsu-waza). A cela
s'ajoutent les entrées au sol ainsi que les dégagements de jambes.

LES FORMES D'ETUDES
L'étude et la pratique du judo revêtent plusieurs
aspects complémentaires et nécessaires à l'évolution, au progrès et au plaisir
des pratiquants.
Pour les débutants, la découverte des gestes élémentaires, propres à chaque
mouvement, se feront sous forme statique, avec un partenaire consentant, sous
les directives du professeur qui précise les points essentiels de déséquilibre,
de placement du corps, etc.
YAKU-SOKU-GEIKO
Lorsque les pratiquants auront assimilé plusieurs
techniques, ils tenteront de les appliquer non plus sous forme statique, mais
dynamique, avec un partenaire n'opposant pas de résistance, mais qui esquive
lorsque son déplacement le lui permet ou que l'attaque n'est pas correctement
appliquée. Aucun des deux partenaires ne cherche à éviter la chute, ce qui est
une bonne occasion de se perfectionner en ce domaine et de dissiper toute
appréhension.
Le but de cet exercice, appelé " yaku-soku-geiko " est de donner à chacun le
sens du déplacement, de la position de son corps et de l'attitude la plus
efficace.
RANDORI
C'est une autre forme d'exercice, où les deux
partenaires, sans aucun souci de victoire ou de défaite, sans aucun enjeu,
s'engagent néanmoins dans une recherche maximum de l'efficacité dans l'attaque.
Aucun résultat n'étant comptabilisé, il n'y a pas d'interruption dans le randori
du fait d'une projection réussie. L'exercice reprend aussitôt. Le randori doit
se pratiquer avec l'esprit libre et résolument offensif, la priorité étant
accordée avant tout à l'attaque, ce qui n'exclut pas l'esquive et la contreprise
lorsque l'occasion s'en présente.
LA COMPÉTITION (SHIAI)
C'est le test ultime, celui qui permet vraiment de
juger de la bonne assimilation des techniques et de leur efficacité. A ce stade,
la notion de victoire prime, puisque le résultat permet d'obtenir des points
pour passer à un grade supérieur, de faire gagner son équipe ou son club lors
d'un tournoi, ou enfin de conquérir un titre de champion. la défense prend, en
compétition, autant d'importance que l'attaque, mais les qualités
psychologiques, la concentration, la confiance en soi, le sang-froid y sont
aussi déterminants.
Quel que soit l'enjeu, cependant, la compétition doit rester un plaisir et
chacun y trouvera, dans la victoire comme dans la défaite, une occasion
d'épanouissement et de découverte de soi-même qui restent le but initial que
visait Jigoro Kano en créant le judo.
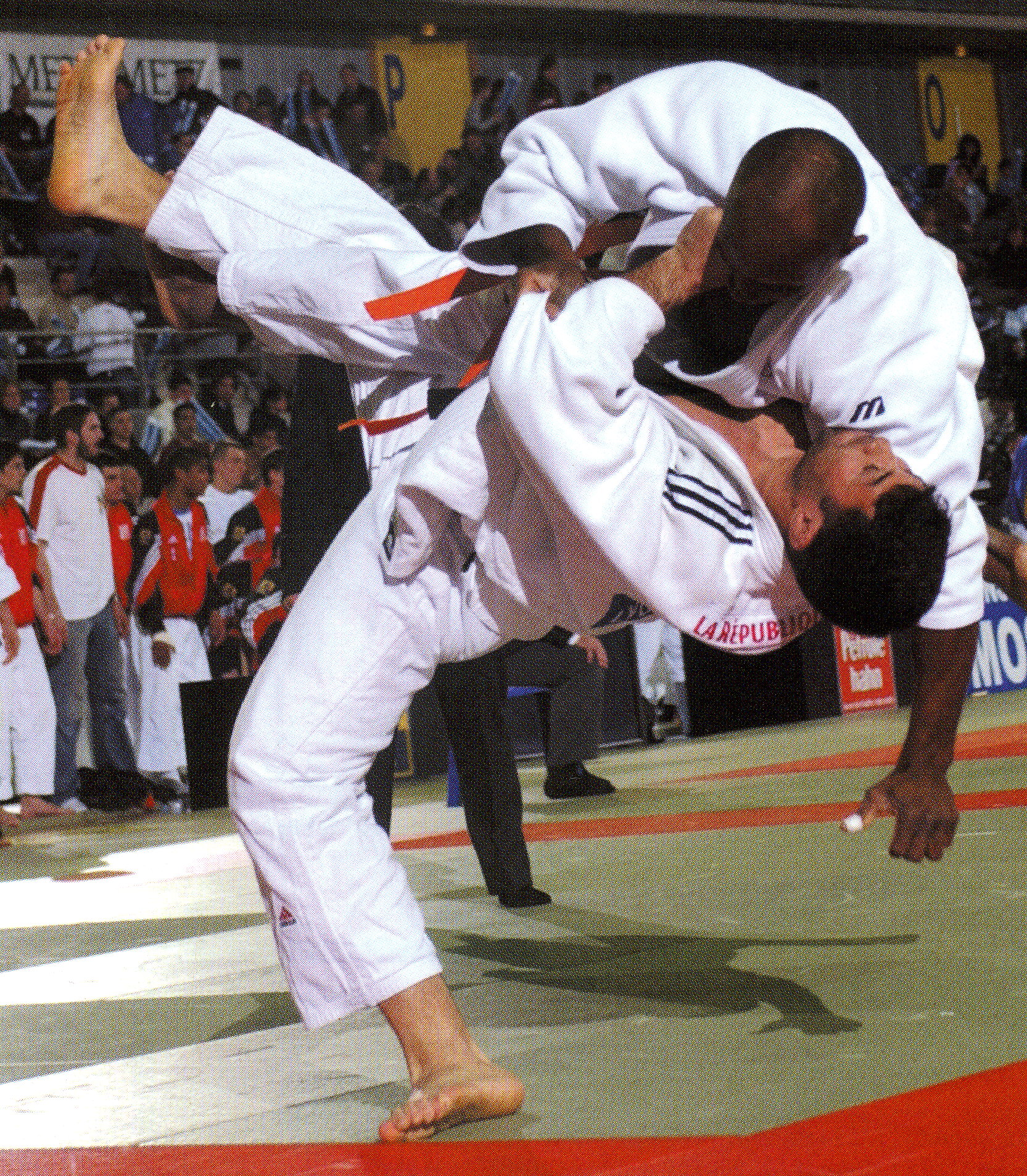
LES RÈGLES DE COMPÉTITION
Les compétitions officielles se déroulent sur des
tapis aux dimensions réglementaires et selon des régies fixées par la Fédération
Internationale de Judo. Elles sont dirigées par trois juges, un arbitre central
et deux juges de coin, dont les décisions sont déterminantes. Ces juges
possèdent une qualification précise, de l'échelon départemental à l'échelon
mondial.
En compétition, les actions sont valorisées selon une progression qui va du "
koka " (3 points) au " yuko " (5 points) puis au " waza-ari " (7 points) et
enfin au " ippon " (10 points), lequel assure une victoire définitive.
Le non-respect des règles est sanctionné par des pénalités. Une pénalité reçue
par un combattant donne des points à son adversaire, le " shido " correspond au
koka (3 points), le " chui " au yuko, le " keikoku " au waza-hari et enfin le "hansoku-make
" ou disqualification, au ippon.
|